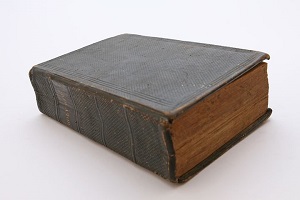
Il y a quelques années, alors que j’étais à Rome, ma femme et moi avons eu la chance de visiter les Musées du Vatican. Avec l’aide d’un guide, nous avons découvert et apprécié de nombreux objets historiques exposés dans la vaste collection du musée. Parfois, après que le guide m’ait donné des informations sur un sujet, je m’approchais de ma femme et commentais discrètement ce que la Bible disait à propos de cet événement ou de ce sujet historique.
Notre guide, conscient de mes remarques incessantes, s’est approché de moi, m’a montré un tableau sur le mur de l’autel, intitulé « Le Jugement dernier », et m’a demandé : « Qu’en penses-tu ? » J’ai observé les images montrant Jésus venant sur les nuées avec ses anges. D’un côté, les bons anges aidaient les rachetés à sortir de leurs tombeaux pour accueillir Jésus dans les airs. De l’autre, les condamnés étaient emmenés sur le Styx vers la damnation éternelle.
Après avoir contemplé le tableau quelques secondes, j’ai répondu : « N’est-ce pas intéressant ? » J’ai expliqué que si les rachetés sortiraient effectivement de leurs tombeaux pour accueillir Jésus dans les airs, ceux qui n’avaient pas choisi le chemin de la justice dormiraient, lorsque Jésus viendrait, dans des tombes pendant mille ans, puis ressusciteraient pour affronter le véritable jugement dernier.
Notre guide a réfléchi un instant et a dit : « Je n’avais jamais vu les choses sous cet angle. C’est logique. » Ce jour-là, j’ai eu l’occasion de donner une étude biblique au Vatican en utilisant le contexte dans lequel nous nous trouvions, lui et moi.
Contextualisation
Mes collègues du Département des Missions utilisent le terme « contextualisation », défini comme « le processus consistant à rendre l’Évangile accessible dans un contexte culturel particulier, de manière compréhensible et culturellement significative, sans perdre la vérité et l’intégrité du message ». 1 Cette pratique n’est pas nouvelle ; on la retrouve dans tout le Nouveau Testament. Paul l’a employée en Grèce ( Actes 17:22-31 ) lorsqu’il s’adressait aux « hommes d’Athènes » (v. 22) et utilisait leur contexte pour relier le Christ à leur « Dieu inconnu » (v. 23).
Jésus a également utilisé la contextualisation avec ses disciples lors de sa promenade à Césarée de Philippe ( Mt 16.16-18 ). Il leur a posé une série de questions concernant son identité. Simon a répondu : « Tu es le Christ » (v. 16). Jésus a alors répliqué : « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle » (v. 18, LSG). Les commentaires s’accordent à dire que l’événement a eu lieu sur le flanc du mont Hermon, à l’emplacement d’une grotte appelée « la porte du séjour des morts ». Jésus s’est servi du paysage et de la culture de l’époque pour illustrer son propos.
La question qui se pose alors est : pourquoi la contextualisation est-elle importante pour atteindre les gens d’aujourd’hui ? Selon Brian Hull, expert en ministère auprès des jeunes, « la théologie se déroule dans un contexte. Elle s’élabore au rythme de la vie des gens, alors qu’ils cherchent à comprendre Dieu et ce que signifie le suivre à la manière de Jésus. Le langage, les récits, les analogies, les paraboles et les métaphores découlent tous de ce contexte. » 2 Si cela est vrai, et je le crois, une évangélisation efficace prend en compte la composition sociale, politique, culturelle et spirituelle en constante évolution de la société.
Lorsque le contexte est ignoré, cela entrave la transmission efficace et pertinente de l’Évangile. Par exemple, « Lorsque le christianisme est entré dans le XXe siècle, il était une religion occidentale affirmée, forte et impériale. Nombre de ses dirigeants ont accepté le dicton érudit selon lequel le XXe siècle serait le “siècle chrétien”… Aucun pronostiqueur n’avait prédit que davantage de chrétiens se rendraient au culte chaque dimanche en Chine qu’en Europe ou en Amérique du Nord. » 3 Que s’est-il donc passé ? La société, la culture et les besoins sociaux ont changé, mais les pratiques d’évangélisation sont restées les mêmes. Le christianisme est quasiment éteint dans le monde occidental.
Inverser les dégâts
Que peut-on faire pour réparer les dégâts, voire empêcher l’inutilité totale de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui ? Premièrement, nous devons comprendre certains faits qui, je l’espère, susciteront un sentiment d’urgence au sein du corps ministériel. Barna rapportait en 2018 que seulement 4 % des membres de la génération Z avaient une vision biblique du monde. Ce chiffre suggère que la plupart des personnes nées entre 1997 et 2012 n’utilisent pas les principes bibliques pour faire des choix. Les pratiques laïques et les conseils de leurs pairs dictent leur vie. Si tel est le cas, nous sommes à une génération de l’extinction en tant qu’Église.
Deuxièmement, les personnes pratiquantes et non pratiquantes voient le monde à travers trois prismes différents.
Le premier est le modernisme, un système de pensée et de comportement caractérisé par la conscience de soi ou l’autoréférence qui imprègne les différents arts et disciplines. Leur question est : qu’est-ce qui est vrai ? Par conséquent, tous les efforts du modernisme visent à prouver ce qui est vrai.
La deuxième perspective est celle du postmodernisme, qui rejette tous les récits, les jugeant inexacts, et les abandonne donc. La question pour les penseurs postmodernes est donc : qu’est-ce qui est juste ? Cela signifie qu’il existe une place pour plus d’une vérité ; tout est relatif.
La troisième perspective est le métamodernisme, qui prône la concurrence et la tolérance entre différents récits et revendique une meilleure version de la vérité dans le domaine des valeurs existentielles. Les métamodernes se demandent : « Qu’est-ce qui est pertinent ? » Autrement dit, ils cherchent une histoire dans laquelle ancrer leurs questions existentielles les plus profondes : « Quelle est mon identité ? Où est ma place ? Quel est mon but ? »
Devinez quoi ? Nous avons la plus belle histoire à raconter ! L’Écriture est le récit de Dieu et, étonnamment, elle est la source des réponses à ces trois questions existentielles et à bien d’autres. Si tel est le cas, pourquoi n’avons-nous pas réussi à atteindre ou à fidéliser les jeunes autant que nous aurions dû ? La réponse réside peut-être dans la méthode.
Quelle est notre méthode ?
L’objectif d’aujourd’hui est de présenter des informations présentées sous forme d’expérience multisensorielle. La méthode d’évangélisation doit impérativement s’adapter à la manière dont les gens peuvent s’identifier au message.
Lorsque le mouvement adventiste du septième jour a débuté, le monde occidental était en plein milieu d’un événement connu sous le nom de Grand Réveil. À cette époque, les gens acceptaient généralement la Bible comme la Parole de Dieu. Même s’ils n’étaient pas engagés, ils connaissaient néanmoins le contenu des Écritures. Les efforts d’évangélisation visaient à convaincre les gens, à l’aide de passages bibliques, de la véracité et de la validité du message adventiste. L’expérience d’évangélisation était essentiellement monosensorielle. Les gens se réunissaient sous des tentes, à l’église ou chez eux pour écouter de longs messages ou des études bibliques de quelques heures. L’écoute était leur principal moyen d’acquérir des informations.
Le point de départ est très différent aujourd’hui de ce qu’il était il y a près de 200 ans. Premièrement, les gens d’aujourd’hui remettent en question la validité de la Bible. Par conséquent, une ignorance générationnelle du récit présenté dans les Écritures s’est développée. Les efforts d’évangélisation ne devraient pas se concentrer sur la conviction des gens de la bonne doctrine, comme c’était le cas par le passé. Aujourd’hui, il faut convertir les gens de la laïcité au christianisme, une tâche bien plus exigeante. On attend aujourd’hui de présenter l’information sous forme d’expérience multisensorielle. Il est clair que la méthode d’évangélisation doit s’adapter à la façon dont les gens peuvent s’identifier au message.
Le langage des histoires
L’auteure Ellen White a écrit : « Le ministre de Dieu doit s’intéresser aux enfants et aux jeunes s’il veut être un pasteur fidèle du troupeau de Dieu. Il doit rendre ses discours clairs et simples, en utilisant un langage facile à comprendre. » 6 Alors, quel est le langage que tout le monde peut comprendre ? Je crois que c’est celui que Jésus utilisait pour enseigner des histoires.
Les neurosciences ont inventé le terme « couplage neuronal ». 7 En termes simples, le couplage neuronal désigne le moment où un auditeur s’identifie au récit d’un narrateur. Il en résulte un effet miroir. Les émotions de l’auditeur correspondent à celles du narrateur. Ce faisant, le cerveau anticipe le dénouement de l’histoire, plaçant l’auditeur au cœur du récit. À mesure que la connexion se développe, la dopamine agit comme un stimulant cérébral, incitant les voies neuronales à enregistrer l’expérience comme agréable.
C’est peut-être pour cette raison que les gens se sont sentis attirés par l’enseignement de Jésus. À un certain moment de l’histoire, nous avons délaissé les récits bibliques pour nous concentrer sur l’utilisation de passages individuels pour étayer nos propos. Nous avons limité l’apprentissage des Écritures à une accumulation cognitive d’informations plutôt qu’à une expérience agréable et pertinente. Si les études bibliques thématiques sont des outils nécessaires, elles ont plus d’impact lorsqu’elles sont liées à une histoire.
Pour atteindre cette génération, nous devons nous efforcer de présenter la macro-histoire, ou l’histoire de Dieu (la vision globale), de manière à les amener à trouver la micro-histoire (leurs relations), puis à leur enseigner comment leur nouveau lien avec les Écritures s’applique aux problèmes de la vie réelle (en utilisant leurs sens). Ainsi, la Bible peut devenir l’histoire dans laquelle ils peuvent ancrer leur identité, développer un sentiment d’appartenance et trouver leur raison d’être en utilisant les capacités que Dieu leur a données pour participer à son royaume. Elle a été contextualisée pour le monde dans lequel ils ont grandi.
- « Ministère contextualisé », Reaching Internationals, consulté le 17 janvier 2025, https://www.reachinginternationals.com/ministry/contextualized-ministry/ . ^
- Brian Hull, « Quelque chose de nouveau : Aperçus historiques de la contextualisation du ministère de la jeunesse en Amérique du Nord », Association of Youth Ministry Educators, 2020, p. 1, https://www.aymeducators.org/wp-content/uploads/Historical-Snapshots-of-Youth-Ministry-Contextualization-in-North-America-by-Brian-Hull.pdf .
- Scott W. Sunquist, Le siècle chrétien inattendu : le renversement et la transformation du christianisme mondial, 1900-2000 (Grand Rapids, MI : Baker Publishing Group, 2015), xv. ^
- Génération Z : la culture, les croyances et les motivations qui façonnent la prochaine génération (Barna Group et Impact 360 Institute, 2018) . ^
- Kara Powell et Brad M. Griffin, 3 grandes questions qui changent chaque adolescent : tirer le meilleur parti de vos conversations et de vos relations (Grand Rapids, MI : Baker Books, 2021). ^
- Ellen G. White , Manuscript Releases , vol. 2 (Silver Spring, MD : Ellen G. White Estate, 1987), 280. ^
- Greg J. Stephens, Lauren J. Silbert et Uri Hasson, « Le couplage neuronal locuteur-auditeur sous-tend une communication réussie », Actes de l’Académie nationale des sciences des États-Unis d’Amérique 107, n° 32 (2010) : 14425–14430, https://doi.org/10.1073/pnas.1008662107 . ^
Auteur: Rogelio Paquini, DMin, est professeur adjoint des ministères de la jeunesse et des jeunes adultes au Séminaire théologique adventiste du septième jour, Université Andrews, Berrien Springs, Michigan, États-Unis.
Source: Ministry Magazine